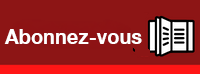Une volontaire de la Custodie raconte le repas de Seder passé avec une famille israélienne.
(Jérusalem/APP) – J’avais très envie de passer un repas de Seder avec une famille israélienne. Après tout, venir habiter plusieurs mois dans un autre pays est une démarche d’ouverture, de découverte. En venant en Terre Sainte, je partais à la recherche de l’Autre, des autres qui habitent cette terre aux multiples visages. J’étais donc invitée à partager ce repas qui inaugure la semaine de Pessach, chez une famille typiquement israélienne.
A mon arrivée, je suis restée interdite devant les trente-cinq couverts qui s’alignaient devant moi. Le seder est l’une des fêtes les plus importantes chez les juifs où toute la famille se réunit pour commémorer la sortie d’Egypte du peuple juif. La soirée est centrée autour du thème de l’esclavage dont les hébreux s’affranchissent et de la traversée du désert avant l’arrivée en pays de Canaan. Avant le début du diner, une tante me prend à part. Elle m’explique que dans cette famille, le diner du seder est un peu particulier. Elle me montre le grand-père assis un peu plus loin qui joue avec le dernier né de cette grande famille, le petit Avi qui a sept mois. Ce grand père de 88 ans, aux yeux rieurs et à l’oreille difficile, est un rescapé d’Auschwitz. Sur la famille de sept frères dont est le représentant, cinq ont survécu à la Shoah. Certains sont devenus très religieux, d’autres ont perdu la foi. « Dieu est mort à Auschwitz, » raconte-t-il à ses enfants. Ce soir, nous lirons comme à tous les seder le récit de la sortie d’Egypte. Mais, dans cette famille, la Haggadah (c’est le nom de ce texte) a été un peu modifiée. Jamais il n’y est question de Dieu, tout ce qui y fait référence a été effacé.
Nous nous asseyons à table et la célébration commence. Les différents membres de la famille lisent le récit tour à tour, alternant les voix. Certains se prennent aux jeux et font presque un one-man-show pour l’occasion. Au fur et à mesure de la soirée nous buvons les quatre coupes de vin rituelles, nous mangeons le pain azyme, l’œuf dur, le raifort et le harosset, un mélange de fruits, de noix, de vin et de cannelle qui représente le mortier utilisé par les hébreux pour construire leurs maisons. Le diner est ponctué de chants, sur des mélodies ashkénazes rythmées et dynamiques, accompagnées au violon par l’un des petits fils. Le diner est joyeux, copieux et riche, il y règne un charmant chaos où se mêlent les rires des adultes et les jeux des enfants. Quelque chose de nostalgique persiste néanmoins, lorsque l’on compare tendrement le jeune violoniste à celui jouait sur les toits des peintures de Chagall. Lorsque l’on m’explique les liens de parenté entre les différents convives, et que l’on ajoute « de ce côté là de la famille, il n’y a plus grand monde… » – tout est dit dans ces points de suspension. Lorsque l’une des plus jeunes pose les quatre questions rituelles – Pourquoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits ? – l’une des tantes rappelle que c’est son grand-père, le plus jeune de sa fratrie qui, il n’y a pas si longtemps mais à une époque bien différente, posait cette même question à ses parents. On lisait alors probablement la Hagadah en yiddish mais on mangeait, comme aujourd’hui, du gefilte fisch et du goulasch le soir de la pâque.
Ce diner était comme sorti d’un roman d’Amos Oz. La soirée semblait suspendue entre deux âges. Une famille ashkénaze, polonaise, survivante, immigrée avant même la création de l’Etat, dont l’un des membres, à peine sorti des camps, a été tué dans la Guerre d’Indépendance, un famille aujourd’hui bien établie, chantante et radieuse.