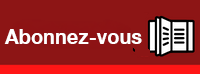Il pourrait réjouir vos palais en France mais chef Johnny a choisi de rester dans son pays parce qu’il s’y sent utile en cuisine. Rencontre avec un apôtre du goût et de la paix.
Mes aubergines braisées, je les ai appelées betinjan il-raheb, parce que leur peau foncée me rappelle l’habit noir des prêtres(1) qu’on croise ici à Jérusalem, mais aussi celui des moines syriaques du monastère Dayro d’Zafaran en Turquie.” Sa large silhouette prise dans une veste blanche de cuisine brodée à son nom, il arbore sur l’avant-bras droit une croix tatouée avec les mots “Seigneur Jésus-Christ” en araméen.
Johnny Goric annonce tout de suite la couleur : cuisinier en chef du Legacy Hotel à Jérusalem-Est, il ne manque pas d’exemples pour décrire sa cuisine et ainsi raconter son parcours. Issu d’une famille chrétienne syriaque installée à Jérusalem depuis les années 1950, Johnny s’est formé à l’école hôtelière Notre-Dame dès l’âge de 16 ans avant d’obtenir une bourse pour étudier d’abord au Lycée François Rabelais, puis à l’Institut Paul Bocuse en région lyonnaise.
“Là-bas, j’ai appris toutes les bases de la cuisine” raconte-t-il, sans oublier d’ajouter, le sourire aux lèvres : “Et j’étais le premier Palestinien !” Un apprentissage très précieux qui lui permet ensuite, une fois de retour, d’être employé par les plus prestigieux établissements de la ville sainte : l’American Colony, le King David.
Lire aussi >> Teta’s Kitchen : la Palestine racontée par ses recettes de grand-mère
À 40 ans aujourd’hui, il œuvre même aux fourneaux du Consulat de France, ce qui l’amène ensuite à ceux du Quai d’Orsay à Paris pendant plusieurs mois. Après un passage à l’Intercontinental de Jéricho, il retourne à Jérusalem sa ville natale “si chère à [son] cœur”.
Johnny se sent en effet la mission d’y rester pour en montrer à ses proches toutes les richesses, malgré les tensions persistantes : “Quitter Jérusalem, ce serait une drôle d’idée. Et puis, c’est ici que je me sens le plus utile pour rendre la vie meilleure et aider les autres”. Un ancrage local qui ne l’empêche pas d’en sortir régulièrement.
Carrefours des goûts
D’une curiosité insatiable, chef Johnny multiplie en effet les séjours en Asie et en Europe pour s’inspirer des plats, des techniques et des ingrédients qu’il découvre sur place. C’est ainsi qu’à l’issue d’un voyage en Thaïlande il décide d’accompagner son poulet au sumac avec des nouilles de riz. “Pour diversifier sa cuisine, il faut toujours être dans un esprit de découverte, explique-t-il. Quand je rentre ici chez moi, alors je me mets au travail. Je suis d’ailleurs connu pour ma cuisine-fusion.”
L’expression laisse souvent perplexe, mais Johnny sait de quoi il parle, peut-être parce qu’il sait d’où il vient. Sa base : la cuisine arabe locale, celle que sa mère cuisinait lorsqu’il était enfant. Il la qualifie d’ailleurs plutôt de levantine, car née d’influences diverses entre le kebab ou chawarma de Turquie, les mezzé du Liban, ou encore le mensaf de Jordanie. “Quelques plats sont proprement palestiniens, nuance-t-il. C’est le cas du m’sakhan, poulet rôti aux oignons sur du pain et parfumé au sumac.”
Mais Johnny hisse ce plat traditionnel à un niveau gastronomique, où la présentation dans l’assiette compte autant que le goût : “Pour présenter le m’sakhan à Barack Obama, j’ai préparé une galantine de poulet accompagnée d’une salade et de petits croûtons, raconte-t-il, non sans fierté. En fait, je pars d’un plat connu que je déconstruis, c’est-à-dire que j’identifie les ingrédients et les présente autrement”. Ce qui ne l’empêche pas de demander régulièrement conseil à sa mère, excellente cuisinière de saveurs orientales.
Cependant, Johnny est bien conscient qu’il ne peut déployer cette même audace culinaire partout. La société palestinienne de Jérusalem-Est et de Cisjordanie n’est pas encore prête pour ce type d’expérience. Les cuisines italienne, méditerranéenne, voire asiatique sont préférées à une cuisine arabe locale qui s’en tient alors à ce qu’on appelle communément la street food ou alors à des plats roboratifs préparés à la maison.
Virus gastronome
Côté israélien, au contraire, le phénomène culinaire prend une place croissante dans les modes de vie. Les établissements se multiplient à Tel Aviv et Jérusalem et la clientèle, amatrice de bons repas pris dehors, favorise la créativité des chefs. Côtoyant le milieu culinaire israélien, Johnny a été touché par le virus gastronome et entend bien contaminer le côté palestinien.
Mais pour cela, il faut former les jeunes. “En Palestine, il n’y a pas de chef professionnel. Le plongeur devient cuisinier au bout de trois ans de plonge ; il n’a aucune base en cuisine, il ne sait pas ce qu’est un bouquet garni. Alors, il se débrouille comme il peut. C’est pour ça qu’à Ramallah, par exemple, on trouve la même offre partout, il y a très peu d’innovation.”
Lire aussi >> Rue Saint-François: nouvelle artère de l’entrepreneuriat palestinien
Fort de ce constat, Chef Johnny œuvre depuis plusieurs mois à la création d’une école hôtelière dont l’ouverture est prévue au mois de septembre 2015 à Ramallah. Seule une formation professionnelle permettra aux jeunes Palestiniens d’acquérir un savoir-faire culinaire et technique, ainsi qu’une connaissance des règles d’hygiène.
Un tel établissement est capital pour l’avenir du secteur touristique en Palestine et surtout pour la cuisine arabe locale, pense-t-il : “Avec la création de cette école, je me projette dans 10 ans, lorsque nous aurons de bons chefs cuisiniers ici, capables d’investir et de renouveler la cuisine palestinienne.”
Ne pas se laisser enfermer
Un tel investissement auprès de ses frères palestiniens n’empêche pas le chef cuisinier de se tourner vers d’autres milieux, bien au contraire : “Je ne veux pas m’enfermer dans une boîte” réplique-t-il, avant de détailler le nom des associations dans lesquelles il s’active.
Notamment le fameux groupe Chefs for Peace (Chefs pour la paix), qui rassemble des chefs israéliens et leurs homologues palestiniens, ou encore l’association internationale Chaîne des Rôtisseurs forte de quelque 25 000 amateurs et professionnels réunis autour de l’appréciation de la bonne cuisine. Johnny s’assure ainsi une visibilité non négligeable en Israël comme ailleurs.
Mais c’est aussi son identité chrétienne qui parle : Johnny fréquente la paroisse syriaque orthodoxe Saint-Marc dans la vieille ville de Jérusalem, ses enfants y servent à la messe et lui-même participe à la parade des scouts lors des grandes fêtes liturgiques. Lors de la veillée de Pâques, il est de ceux qui reçoivent le feu sacré au Saint-Sépulcre. “En tant que chrétien, je crois en la paix et au respect de chaque individu. Je veux que mes trois enfants grandissent dans un pays pacifique. J’ai des amis palestiniens et des amis israéliens, j’aide et je cuisine des deux côtés. Nous sommes tous des êtres humains au final”.
Vidéo >> Le za’atar, de la plante à l’épice
Sans tomber dans un angélisme de bon ton et conscient que certains ne peuvent entendre ce discours, Johnny se veut avant tout pragmatique : “Il faut regarder les choses en face. Les Israéliens sont là, à côté de nous. Il faut faire avec, point. Nous pouvons vivre ensemble. La violence ne changera rien à la situation, bien au contraire”.
Alors c’est par son travail que Johnny entend transmettre son message fraternel et poser ainsi sa petite pierre au fragile édifice de la paix : la transmission est au cœur de sa mission. A côté des fourneaux du Legacy Hotel, chef Johnny enseigne également à l’école hôtelière Notre-Dame à Jérusalem, seul établissement de ce type actuellement ici.
Tout semble donc lui sourire. Il est d’ailleurs plusieurs fois récompensé pour ses prouesses culinaires lors de festivals gastronomiques : trois médailles d’or à Bucarest, une autre au Luxembourg en 2010, une médaille d’argent à Istanbul en 2012. Bien sûr il reconnaît que le quotidien ici n’est pas toujours facile : “Je sais que si j’étais resté en Europe, les choses seraient allées plus vite, je serais plus connu, j’aurais déjà écrit un livre, je présenterais un programme à la télévision…”
Chef Johnny idéalise peut-être sa carrière par-delà la Méditerranée. Cependant, il sait que sa place est ici à Jérusalem, une conviction rehaussée par le mystère de la ville sainte, théâtre du dernier repas du Christ avec ses disciples. Le regard noir et pétillant, il ajoute alors en guise de conclusion : “Rompre le pain avec ses amis, ce n’est jamais anodin, bien au contraire, c’est capital. Il peut se passer tant de choses pendant un repas.” Les évangiles ne le démentiront pas.
(1). Se dit raheb en arabe.
Dernière mise à jour: 19/11/2023 21:53