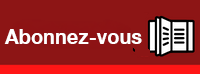Les implantations juives installées au cœur du territoire qui, selon le processus de paix, devrait devenir la Palestine emploient quelque 30 0000 ouvriers arabes. Qui sont ces Palestiniens qui font fonctionner les colonies israéliennes ? Pourquoi et dans quelles conditions y travaillent-ils quotidiennement ?
(Ramallah) – Tout le monde dehors ! Cette semaine, les travailleurs palestiniens se sont vu refuser l’accès aux colonies israéliennes de Cisjordanie, après deux attaques successives dans des implantations juives, dimanche 17 et lundi 18 janvier. Ce dimanche-là, une mère de famille israélienne avait été tuée chez elle, à Otniel, une colonie de l’extrême-sud de la Cisjordanie ; et le lendemain, une femme enceinte avait été blessée à l’arme blanche à Tekoa, ville juive située entre Hébron et Bethléem.
Mardi, les autorités israéliennes ont donc décidé de fermer l’accès de toutes les colonies aux Palestiniens qui y travaillent (environ 30 000 personnes). L’interdiction a été partiellement levée le lendemain, mais elle est restée en vigueur pour les colonies des régions de Bethléem, Hébron, Naplouse et Ramallah.
Qui sont ces Palestiniens employés dans des colonies israéliennes ? Pourquoi et dans quelles conditions y travaillent-ils quotidiennement ?
A 21 ans, Samir s’apprête à commencer ses études de commerce. Mais ce n’est pas gratuit… Pour se les offrir, ce Palestinien de Ramallah a dû travailler deux ans et demi en tant qu’ouvrier dans une usine agro-alimentaire. Un travail d’autant moins plaisant que son employeur n’était pas palestinien mais israélien : l’usine où Samir était employé se trouve à Maale Adumim, près de Jérusalem, la plus grande colonie israélienne de Cisjordanie.
« Etre employé par un Israélien, c’était humiliant, raconte le jeune homme. Mais je n’avais pas le choix, je n’avais pas trouvé de travail à Ramallah. Le boycott, c’est une belle idée, mais impossible à appliquer. Même notre gouvernement ne parvient pas à résister à la colonisation : comment le pourrais-je ? » A 280 shekels (environ 65 euros) la journée de douze heures, Samir ne s’estimait « pas à plaindre ». A un poste similaire, c’est certain, un employeur palestinien l’aurait bien moins payé.
Avec un taux de chômage de 20%, la Cisjordanie voit depuis de longues années sa main d’œuvre filer vers Israël voisin. Mais les permis de travail y étant de plus en plus difficiles à obtenir, ce sont désormais les colonies israéliennes qui attirent ces demandeurs d’emploi. Ils sont environ 30 000 à se rendre tous les jours en zone C (territoire palestinien contrôlé par Israël) avec un permis de travail – soit deux fois plus qu’il y a dix ans. Ces autorisations d’entrée sont régulièrement réévaluées en fonction de la situation sécuritaire.
Un œil extérieur aurait vite fait de déceler la dimension vicieuse de ce système : l’occupation israélienne favorise le chômage des Palestiniens, ce qui les pousse à accepter de travailler dans des colonies, ce qui alimente l’occupation israélienne… La société palestinienne semble pourtant considérer ces ouvriers avec indulgence : « Vous savez, ils n’ont pas le choix », entend-on souvent à leur propos.
La plupart des 30 000 employés travaillent dans les vingt zones industrielles israéliennes de Cisjordanie : les principaux secteurs d’activité sont le textile, la sidérurgie et le bâtiment. Certains travaillent aussi dans les services, comme les supermarchés israéliens Rami Levy, présents dans quatre colonies.
A cela s’ajoutent les quelque 5000 Palestiniens à travailler en zone C sans permis. C’est surtout le cas dans les exploitations de la vallée du Jourdain, le « grenier agricole » de la Cisjordanie : situées à l’extérieur des enceintes clôturées de ces 37 colonies, les fermes ne nécessitent pas de permis d’entrée. Parmi ces travailleurs clandestins, on trouve des centaines d’enfants, dont le nombre augmente à la saison des récoltes. En avril dernier, Human Rights Watch a publié un important rapport dénonçant le travail des enfants dans ces colonies : la plupart ont arrêté l’école pour y travailler à plein temps.
Les employeurs israéliens que nous avons rencontrés assurent tous entretenir de bonnes relations avec leur main d’œuvre palestinienne. « A part mon fils et moi, aucun Israélien ne travaille dans ma ferme », explique Hanan Pasternak, qui fait pousser des poivrons à Netiv Hagdud, une trentaine de kilomètres au nord de Jéricho. « J’emploie cent Palestiniens, qui peuvent ainsi nourrir leurs familles. »
Tandis que les Israéliens occupent des postes à responsabilité, les Palestiniens forment une main d’œuvre bon marché. Entre les deux, les différences de traitement sont parfois criantes. Ali Husein Khalil les ressent tous les jours, depuis bientôt vingt ans qu’il travaille dans une biscuiterie de Maale Adumim. « La salle où les employé israéliens peuvent se reposer a l’air conditionné, pas la nôtre, souligne ce Palestinien massif de 39 ans (mais qui en fait dix de plus). De toute façon, on n’a jamais le temps d’y traîner, puisque l’on n’a qu’une demi-heure de pause déjeuner. Les Israéliens, eux, ont une heure et demie. »
Hanna Zohar est chargée de la protection de ces travailleurs à l’ONG israélienne Kav LaOved. « Le droit du travail israélien prévoit des protections sociales pour ces Palestiniens, mais ces mesures sont peu appliquées, déplore-t-elle. Les abus reposent sur la faiblesse de travailleurs qui, rappelons-le, vivent sous occupation : certains craignent de perdre le travail s’ils se plaignent, d’autres ont fini par se convaincre qu’ils ne méritaient pas plus d’argent. » Ainsi sont-ils nombreux à ne pas gagner le salaire minimum israélien (164 shekels par jour, soit 38 euros) ni à être indemnisés autant qu’ils le devraient pendant un arrêt maladie.
Il y a aussi l’épineuse question des accidents du travail. La plupart du temps, ces ouvriers sont emmenés dans des hôpitaux palestiniens et non israéliens, de meilleure tenue : ils en ont pourtant le droit, et sont même couverts par l’assurance que souscrit leur employeur, mais ils l’ignorent souvent. S’ils se font soigner dans un hôpital palestinien, ils doivent au contraire payer les frais de leur poche et ne sont remboursés qu’a posteriori, et seulement si l’incident a été déclaré « accident du travail ».
« Ces dernières années, des procès ont été remportés, ce qui a réveillé les consciences, reprend Hanna Zohar. Mais tant que le gouvernement ne forcera pas les employeurs à appliquer la loi, ils ne le feront pas. Et avec ce gouvernement très à droite, j’ai peur que ce soit encore plus difficile qu’avant. »
Pour un jeune Palestinien, travailler dans une colonie est rarement un rêve d’enfance, mais encore faut-il trouver les ressources matérielles pour en sortir… Lafi Swafta a passé cinq ans à ramasser des tomates et des concombres dans la colonie de Mehola, dans le nord de la vallée du Jourdain. Ce Palestinien aux yeux clairs, aujourd’hui âgé de 23 ans, ne cherchait même pas à changer de travail. « Je savais que je n’en trouverais pas d’autre », se souvient-il. Mais une rencontre de hasard a changé cet état de fait.
Rachid, activiste de l’association Jordan Valley Solidarity, était justement en train de monter une pièce de théâtre. Celle-ci racontait la vie dans la vallée du Jourdain : l’éducation, la santé, et bien sûr le travail dans les colonies. Lafi a été pressenti pour participer à ce projet de pièce, où il tient le rôle d’un Palestinien qui procure à ses congénères des emplois dans les colonies. « Ce type, je le connais dans la vraie vie, sourit Lafi. Alors c’est agréable à jouer. »
Depuis un an, la pièce est donnée dans la vallée du Jourdain, mais aussi dans les principales villes de Palestine et de Jordanie. Lafi consacre huit jours par mois à ce projet, payé 100 shekels (environ 23 euros) par jour. Le reste du temps, il travaille dans le champ de son père. « Mais si le projet s’arrête, prévient-t-il, je devrais peut-être retourner travailler dans une colonie. »