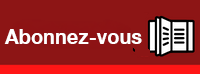Ces jours-ci en Terre Sainte, les Israéliens ont célébré l'indépendance et les Palestiniens leur tragédie nationale, que nous relisons avec les yeux d’Hejar Zghari, réfugiée à Bethléem.
Une benne à ordures brûle, remplissant l’air d’une odeur aigre. C’est un jeudi matin et il n’y a presque personne dans les rues étroites du camp de réfugiés de Dheisha, aux portes de Bethléem. Hejar Zghari nous ouvre les portes de sa maison, entourée d’autres bâtiments en béton du camp, peuplé de 15 000 réfugiés palestiniens.
Hejar a 67 ans («Je suis l’aînée de ma famille dans le camp »), née dans la diaspora et élevée comme réfugiée. Elle est diplômée, s’est mariée et est devenue infirmière, mère et grand-mère. Elle porte des vêtements traditionnels et nous accueillant avec une assiette de fruits, elle raconte : «Je suis originaire de Zakaria, entre Ramla et Hébron : notre village était un village de paysans, il y avait des oliviers, des champs cultivés de céréales et des vergers. Mes cinq frères sont nés là-bas. Ma mère et mon père avaient une belle maison, beaucoup d’animaux, des lapins, des moutons, des chèvres. Quand les sionistes sont arrivés, ils ont été chassés du village. Les adolescents et les jeunes de 30-35 ans ont été emprisonnés. Beaucoup d’entre eux ont été tués, une femme enceinte a même été assassinée. Le reste du village, un peu plus de 1 500 personnes, était terrorisé : ils se sont tous enfuis. »
Un souvenir vivant, une plaie brûlante
La mémoire orale de la Nakba, la catastrophe du peuple palestinien (pas moins de 700 000 personnes, peut-être un million, déplacées de force de leurs terres, plus de 530 villages détruits, toute la société palestinienne dévastée), résiste parmi les maisons des camps réfugiés dans les territoires occupés comme dans le reste du monde arabe. Les nouvelles générations décrivent les villages d’origine comme s’ils les avaient visités la veille et la fuite, comme s’ils l’avaient vécue eux-mêmes.
« Ma famille s’est réfugiée dans une région près d’Hébron ; ils faisaient des kilomètres pour trouver l’eau afin de se laver et de cuisiner. Ils n’avaient rien, ils n’avaient ni vêtements ni chaussures si ce n’est ceux avec lesquels ils s’étaient enfuis – poursuivit Hejar -. Après quelques mois, ils ont pensé pouvoir retourner à Zakaria et ont tenté. Mais les milices tiraient sur quiconque s’approchait : ils ont tué beaucoup de gens. Quelques mois après, ma famille s’est installée à Jéricho pendant un an sans aucune aide. Ce n’est que plus tard qu’ils sont arrivés au camp de Dheisha : je suis la première à être née ici, en 1951 sous une tente. »
Zakaria, quoique à quelques kilomètres à vol d’oiseau, semblait désormais très loin. Le village a été détruit. D’une communauté très ancienne, remontant à quelques siècles avant la naissance du Christ, seules quelques maisons furent sauvées, avec l’école et la mosquée. Le nom du lieu vient du prophète Zacharie, qui a vécu au IVème siècle avant JC. Et là, disent fièrement les habitants les plus âgés, il semble que Joseph et Marie se soient arrêtés avant d’arriver à Bethléem. À la place, le nouvel État d’Israël a immédiatement construit une autre communauté, la baptisant d’une manière similaire : Zekharia.
« Avant la construction du mur de séparation (dans les premières années de ce siècle – ndlr), quand ma mère était encore en vie, nous sommes allés visiter le village. La maison de mon grand-père était l’une des rares qui restait, dans laquelle vivait une famille de juifs irakiens. Ma mère a frappé, demandé à entrer, mais ils l’ont brutalement chassée. Elle a pleuré. »
Le mari d’Hejar acquiesce. Il enseigne l’anglais dans le camp, ensemble ils ont construit cette maison après avoir passé leur enfance dans une tente tout d’abord, puis dans une pièce de quelques mètres carrés : « En 1950, l’Unrwa (agence créée par l’ONU pour assister les réfugiés palestiniens – ndlr) a commencé à construire les premières structures : une pièce pour chaque famille, avec une petite cuisine. Il y avait une salle de bain commune pour tout le voisinage, tous les 500 mètres. Les services étaient sales, il fallait attendre : dans les premières années il y avait au camp 5 000 personnes, des familles qui venaient de villages différents et ne se connaissaient pas. Nous avons dû reconstruire un tissu social à partir de rien, tout en vivant un traumatisme individuel et collectif. Ce fut une période difficile, le fait d’être soudainement devenus réfugiés avait détruit les relations entre les gens, les familles avaient perdu leurs maisons, leurs terres, leurs animaux pour se retrouver sous une tente. Il n’y avait plus de sécurité, il n’y avait plus de sentiment de stabilité ni d’indépendance : d’une vie aisée, à notre petite échelle, dans notre village, nous étions passés à une survie aidés de l’Unrwa, avec pois chiches, lentilles, farine. »
Hejar nous montre une photo : c’est son neveu, il était l’année dernière le meilleur élève de Cisjordanie. « Nous avons tous fréquenté les écoles primaires de l’Unrwa, seulement l’école supérieure à Bethléem. Elle coûte plus cher, mais ici il n’y en a pas. Dès le début, l’école était fondamentale dans le camp : elle était considérée, et est toujours considérée aujourd’hui, comme le seul moyen d’améliorer sa situation. J’ai obtenu mon diplôme en 1971 et ai commencé des études d’infirmière : toute ma vie, j’ai travaillé au Caritas Baby Hospital de Bethléem. C’est ma mère qui m’a poussée à étudier, c’était une femme très intelligente. Je me demande souvent ce qu’elle aurait pu devenir si elle avait pu étudier.
C’était les premières années de l’occupation israélienne de la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est, avec la guerre des Six Jours (1967), qui a de nouveau dénaturé la figure de la Palestine : « Mes oncles se sont tous enfuis – se rappelle Hejar – alors que mes parents ne voulaient pas partir : ils disaient qu’ils avaient déjà fui une fois, cette fois ils resteraient et mourraient ici. »
Notre hôte nous accompagne dehors, pour rendre visite aux voisins. Beaucoup d’entre eux vivent encore dans les pièces de béton construites par l’Unrwa il y a près de 70 ans, quelqu’un en a fusionné deux-trois pour en faire une petite maison. Un vieil homme nous montre son mini-marché, des sachets de riz, de la farine, de l’huile éclairée par une ampoule : la petite fenêtre avec des grilles ne laisse pas entrer assez de lumière.
Non loin, une autre porte ouvre sur trois pièces où vivent trois familles. Les enfants jouent, les mères nous offrent un jus de fruit. Sur les murs les affiches avec le visage de Yasser Arafat. « Au fil du temps, la situation s’est dégradée – poursuit Hejar -, nous avons toujours vécu cette situation comme temporaire, convaincus de revenir. Aujourd’hui, l’espoir de toujours est en train d’être brisé tant à cause de la politique du président américain Donald Trump que de la crise (financière) de l’Unrwa. Aujourd’hui, les services sont presque nuls, à part les écoles. Il n’y a pas de médicaments : je souffre de diabète et l’Unrwa ne peut pas tout couvrir. Il n’est pas en mesure de fournir des services spécialisés : pour tout autre type de traitement, nous devons nous rendre seuls à Bethléem, dans les hôpitaux publics. Le problème est politique : en réduisant les services, ils essaient de dire que les réfugiés sont partis, qu’ils n’existent plus. Mais peu importe : même dans cent ou mille ans, cette terre restera la nôtre. Trump peut dire ce qu’il veut de Jérusalem, la ville parle d’elle-même et personne ne peut changer son histoire, son identité ».