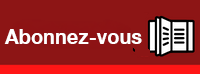Extérieurement on reconnaît les haredim (pour le sens des mots
en italique, voir le glossaire page 31) à leurs papillotes de cheveux bouclés et à leur grand chapeau noir. Mais on connaît peu le quotidien des quartiers très fermés où vivent ces hommes en noir. Immersion au sein du monde de l’ultra-orthodoxie juive
avec la socio-anthropologue Florence Heymann.
Mea Shearim, quartier ultra-orthodoxe de Jérusalem, à seulement quelques centaines de mètres de la Vieille ville. Monde hors de la mode, monde hors du temps, monde hors du monde. Les hommes portent des papillotes plus ou moins longues devant les oreilles, bouclées à l’anglaise, et une longue barbe, pas toujours entretenue. La chemise blanche est de rigueur, mais la couleur du bekeshe, leur longue veste, varie. Si la plupart optent pour le noir, d’autres se laissent tenter par des rayures grises. Les femmes portent, dans des couleurs sombres, des jupes amples tombant sous les genoux. Leurs cheveux sont couverts. D’une main elles guident souvent une poussette et de l’autre tiennent un ou deux jeunes enfants. Leurs vêtements colorés tranchent dans cet univers noir et blanc.
Ces haredim (pour le sens des mots en italique, voir le glossaire p. 31) Florence Heymann les connaît bien. Socio-anthropologue au CNRS, rattachée jusqu’à janvier 2016 au Centre de recherche français de Jérusalem (CRFJ), elle a intégré l’association Hillel, qui vient en aide aux jeunes qui quittent le monde ultra-orthodoxe (voir encadré p.37). “On ne peut pas définir juridiquement ce qu’est un haredi, explique-t-elle, mais de fait, on les remarque avant tout par leur habillement.” Des tenues moins homogènes qu’on pourrait le penser, reflets d’une communauté fragmentée.
Une communauté plurielle
La partition de la communauté est d’abord géographique entre ashkénazes et séfarades. Les différences sont plus culturelles que cultuelles. L’ultra-orthodoxie ashkénaze est historiquement divisée. Elle se scinde entre hassidim et mitnagdim, appelés couramment litaim, car les yeshivot lituaniennes furent particulièrement actives dans la naissance de ce mouvement. Là encore, les différences théologiques sont ténues. L’opposition porte surtout sur l’organisation très hiérarchisée des hassidim, jugés idolâtres par les litaim. On retrouve cette tripartition dans les vêtements. Papillotes très longues et barbe hirsute caractérisent les hassidim. Papillotes plus courtes portées derrière les oreilles et barbe taillée sont plutôt l’apanage des litaim ou des séfarades. Le chapeau, lui, varie en fonction des divers sous-groupes présents dans chaque branche.
Les communautés hassidiques sont organisées en cour. “C’est une référence à la monarchie, explique Florence Heymann. Le dirigeant de la communauté, l’admor (1), ressemble à un roi. Par exemple, l’admor de Gur (la communauté hassidique la plus importante, NDLR) a été hospitalisé il y a quelque temps. Le ministre de la Santé, issu de cette communauté, a fait privatiser 4 chambres d’hôpital pour qu’il soit accueilli avec sa cour.” La fonction est héréditaire et la communauté très hiérarchisée, “un fonctionnement proche des castes”.
Lire aussi >> Un juif israélien sur trois sera ultra-orthodoxe d’ici 2050
La communauté lituanienne est, à l’opposé, organisée en groupes plus petits, réunis autour d’une yeshiva. Ces groupes sont dirigés par un gadol Batorah, un “grand dans la Torah”. “Les haredim séfarades ont un fonctionnement similaire à celui des lituaniens, car avant d’avoir des institutions propres, ils ont fréquenté celles des lituaniens”, ajoute Florence Heymann. Dans ces trois communautés, les mariages sont arrangés, et les transfuges très rares.
Chacun de ces trois groupes est divisé en plusieurs sous-groupes. Les nuances résident principalement dans la rigueur des différentes règles de la communauté. La vie quotidienne est codifiée au millimètre près par les autorités rabbiniques. “Les ultra-orthodoxes se considèrent comme les gardiens de la tradition de la Torah et du Talmud”, explique Florence Heymann. Les 613 mitzvot, commandements bibliques recensés par la tradition, sont au cœur de cette législation. Ils sont complétés par la halakha, la loi juive définie par les sages, afin de préserver la pureté du croyant. “Tout est réglé, de la tenue vestimentaire au nombre de baisers durant une relation intime”, poursuit la socio-anthropologue. Les commandements rabbiniques s’invitent ainsi jusque dans la chambre à coucher des époux. En comparaison la doctrine chrétienne dans ce domaine s’apparente à de monstrueuses bacchanales. Chez les haredim, les sexes sont strictement séparés. Dans les bus ou dans la rue, hommes et femmes ne sont jamais côte à côte, pas même un couple. Certains groupes extrémistes demandent aux femmes mariées de raser leurs cheveux, réputés susciter le désir, ou interdisent aux hommes d’appeler leur épouse par son prénom.

La vie dans le ghetto
La yeshiva, fréquentée uniquement par les hommes, est au cœur de la vie de la communauté haredi, quelle qu’elle soit. “Il y a trois types de yeshivot, indique Florence Heymann. La yeshiva ktana, équivalent du collège, la yeshiva gdola, équivalent du lycée, et le kollel, pour les hommes mariés.” La vie des hommes ultra-orthodoxes est entièrement dédiée à l’étude la Torah et du Talmud. “Cela est apparu avec l’État d’Israël. Avant, les haredim allaient à la yeshiva, puis éventuellement au kollel durant quelques années. Ensuite, ils apprenaient un métier et travaillaient. Aujourd’hui pour la plupart, ils ne travaillent pas.” Et n’acceptent pas non plus de faire le service militaire qui les distrairait de leurs études. Dans les yeshivot, à partir du niveau lycée, on met de côté l’étude de la Torah pour se consacrer exclusivement au Talmud.
Les études des jeunes ultra-orthodoxes se limitent aux textes sacrés. Ils n’étudient pas les mathématiques, ni la géographie, ni les sciences. L’histoire se résume à l’Histoire sainte : le mot dinosaure est inconnu, puisqu’il n’est pas dans la Bible, puisque le monde a 5778 ans. Ils n’étudient pas davantage la philosophie, ni même la pensée juive. Aucune formation professionnelle, puisque la vie sera consacrée à l’étude. Cette ghettoïsation culturelle est renforcée par l’interdiction des téléphones portables, télévisions et autres objets de communication et d’information, si ce n’est les journaux officiels, en yiddish, ou dans les communautés moins rigoristes, les téléphones casher, bridés pour ne donner accès qu’aux contenus religieux orthodoxes.
L’isolement culturel est renforcé par l’isolement géographique. “Parler de ghetto n’est pas une exagération, selon Florence Heymann, car les ultra-orthodoxes le revendiquent eux-mêmes. Il y a une réelle volonté d’ériger des murs afin de se mêler le moins possible à la culture environnante, moderne et cosmopolite.” Tous ceux qui ne sont pas haredim, y compris les juifs les plus observants, sont des goyim, des non-juifs, dont il faut se protéger. Effectivement, la population haredi, qui représente actuellement un tiers de la population hiérosolymitaine, vit dans des quartiers séparés, comme Mea Shearim. Alors qu’ils ne représentent que 8 à 10 % de la population israélienne, ils sont 170.000 ultra-orthodoxes sur 189 000 habitants à Bnei Brak, ville de la banlieue de Tel Aviv.

La population haredi est de plus en plus fragmentée. Ces jeunes hommes en noirs pratiquent la capoeira, un art martial brésilien mêlant danse et acrobaties.
Colosse aux pieds d’argile ?
Le tout est accompagné d’une coercition communautaire très forte. Cette obéissance est partiellement volontaire du fait d’un certain confort intellectuel trouvé dans un système ultra-codifié où toute remise en question est exclue, explique Florence Heymann : “Il y a des côtés extrêmement rassurants, avec notamment une forte solidarité interne. La charité fait partie des valeurs fondamentales”. Néanmoins, pour la chercheuse, on peut parler d’emprise psychologique dans certains cas : “Je pense que beaucoup de ces groupes ont un fonctionnement sectaire, ils en ont toutes les caractéristiques.”
Lire aussi >> Israël : les haredim bientôt appelés sous les drapeaux
Pour autant, l’ultra-orthodoxie juive est loin d’être homogène et, toutes proportions gardées, certaines communautés sont plus ouvertes. Il existe aux périphéries des contacts avec le reste de la société. “Chez les lituaniens, réputés plus ‘libéraux’, on commence à voir apparaître des yeshivot professionnelles. Certes l’acceptation par les communautés est très mitigée puisque l’on considère que ceux qui les fréquentent sont des moins que rien, mais cela permet à des hommes d’intégrer le marché du travail.” Environ un tiers des hommes haredim travailleraient aujourd’hui. L’ouverture vient aussi des femmes à qui on enseigne les matières profanes, les études religieuses leur étant interdites. Moitié d’entre-elles, bien que mères de 6 ou 7 enfants en moyenne, occupent un emploi qui permet de faire vivre le foyer. “Et si elles ne le disent pas, certaines font carrière, ajoute Florence Heymann. Elles sont expert-comptables, avocates…”
Enfin, les recherches de Florence Heymann laissent penser que de plus en plus de haredim vivent une double-vie. On les appelle marranes. Dans leur quartier, ils sont comme leurs voisins, rien ne les en distingue. Quand ils sortent, ils changent de vêtements, rangent leur kippa dans leur poche, car ils ont perdu la foi. “De combien de personnes parle-t-on ? Il est très difficile de le savoir. Ils sont certainement des centaines, peut-être même des milliers, et pourquoi pas des centaines de milliers.” Et combien ont un téléphone ou un ordinateur portables non-casher caché sous l’oreiller, au risque de se faire bannir de la communauté ? Impossible de les dénombrer. Seule certitude, les frontières du monde ultra-orthodoxe se brouillent.♦
1. Admor est l’acronyme de Adonainu, morainu, ve rabbeinu, notre maître, notre professeur et notre rabbin.
Contre-lumières juives
L’orthodoxie juive est née contre la Haskala, les Lumières juives en français, qui remet en cause un certain nombre de principes traditionnels. Les idées des Lumières au XVIIIe siècle fondent philosophiquement les droits inhérents et sacrés de chaque personne humaine. La Révolution française qui s’ensuit marque ainsi un tournant sur le Vieux continent : les juifs sont considérés comme libres et égaux aux autres citoyens devant la loi, à défaut de l’être dans une population gangrenée par des préjugés antisémites. Partant de ce constat les maskilim, partisans de la Haskala, promeuvent alors l’émancipation définitive des juifs par leur sortie du ghetto au tournant du XIXe siècle.
Ainsi, on considère traditionnellement le philosophe Moïse Mendelssohn (grand-père du compositeur) comme l’initiateur de ce mouvement, notamment pour sa traduction de la Torah en allemand. L’éducation est centrale pour les maskilim, comme elle l’est pour les philosophes des Lumières. Cela devait se traduire par l’enseignement de matières profanes dans les écoles juives, l’apprentissage et l’usage de la langue vernaculaire plutôt que du seul yiddish, l’exercice de professions précédemment délaissées, comme l’artisanat et l’agriculture. Un groupe de rabbins allemands alla jusqu’à proposer l’abandon de la circoncision. Néanmoins, l’échec de l’inculturation des juifs signa l’effacement du mouvement au profit du sionisme naissant dans la mouvance du réveil des nationalités au milieu du XIXe siècle.
Les “sortants vers la question” : morts pour les haredim, qui pour la société ?
Dans son ouvrage Les Déserteurs de Dieu – Ces ultra-orthodoxes qui sortent du ghetto (Grasset, 2015), Florence Heymann s’est intéressée aux jeunes qui quittent le monde haredim. On leur donne le nom de “sortants vers la question”, rappelant ainsi que la sortie n’est pas un lâche abandon de règles trop contraignantes, mais bien plutôt l’entrée dans un environnement instable par une remise en cause courageuse d’un système de certitudes indiscutables.
Courage, le mot est sûrement faible. Quitter le monde haredim, c’est abandonner sa famille. Certaines portent le deuil quand un enfant quitte la communauté, voire célèbrent des funérailles en bonne et due forme. C’est aussi condamner cette famille que l’on quitte, car dans ce monde de mariages imposés où la pureté de la lignée est déterminante, la fratrie d’un sortant devient un “second choix” dans les arrangements matrimoniaux. Courageux aussi le choix de se retrouver apatride socialement, peu de dispositifs étant mis en place par l’État pour intégrer ces sortants, et difficile étant l’intégration tant le fossé est grand avec la société israélienne contemporaine.
Dernière mise à jour: 06/02/2024 13:03