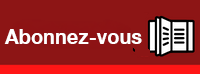Consul général de France à Jérusalem de 2002 à 2005, ambassadeur de France à Kaboul les trois années suivantes, Régis Koetschet a passé six années comme “Diplomate dans l’Orient en crise”. Titre de l’ouvrage qu’il publie et dans lequel celui qui fut proche d’Arafat voit la diplomatie culturelle et la rencontre “par la peau” comme essentielles.
Qu’est-ce qui a motivé la rédaction de votre livre ?
Quand j’ai quitté Kaboul en 2008, je concluais une séquence hors norme aux avant-postes de l’après-11 septembre. Jérusalem et l’Afghanistan, à très forte identité, s’inscrivaient dans une actualité extrême. J’ai voulu donner mon témoignage sous forme de chroniques et montrer comment un diplomate, notamment à Jérusalem, pouvait être utile.
Par ailleurs, je me suis beaucoup investi dans les affaires afghanes à titre associatif. Aussi ai-je voulu rendre par mon livre quelque chose aux Palestiniens à un moment où l’on a l’impression qu’ils ne sont pas reconnus comme ils devraient l’être.
Vous écrivez que Jérusalem est un “poste stressant”…
C’est un poste compliqué qu’il faut aborder avec rigueur, professionnalisme, concentration, prudence, parfois avec discrétion et dans l’idéal, avec sang-froid. Il faut être sur tous les fronts, très présent à tous et porter une grande attention à ses équipes.
J’ajoute que si le poste requiert de nombreux déplacements, ceux-ci s’effectuent dans un périmètre relativement restreint de Jénine (nord de la Cisjordanie) à Rafah (bande de Gaza), ce qui aide énormément à être proche des réalités du terrain.
Est-ce justement dans un tel contexte que le concept de “diplomatie par la peau” dont vous êtes adepte, prend tout son sens, et ce plus qu’ailleurs ?
Cela signifie qu’on apprend uniquement en allant au contact direct des personnes et en les mettant au centre de ses analyses. Autrement dit tout ce qu’on ne peut pas apprendre par simple note diplomatique. Dans les pays en crise, cette “diplomatie par la peau“ est – ne serait-ce qu’à travers une tasse de thé – cruciale car on affiche un élément de confiance, d’amitié par le simple fait d’être là.

Régis Koetschet au Consulat général de France, rue Émile Botta à Jérusalem, en compagnie du patriarche latin de Jérusalem de l’époque, S.B. Michel Sabbah, et de Michel Barnier, ministre des Affaires étrangères. © Photos Collection Régis Koetschet
Votre séjour à Jérusalem a été dominé par la Seconde Intifada et votre relation avec Yasser Arafat. Se résume-t-il aux pressions que la France a exercées sur lui ?
Il est vrai que la situation de l’époque nous impose de faire presser un peu le mouvement. Il s’agit de mettre l’Autorité palestinienne sur des rails et cela doit passer par des réformes, par la création d’un poste de Premier ministre, par la composition d’un gouvernement… Et on voit un Arafat enfermé dans un petit bureau mais aussi enfermé dans un système et dans son temps à lui qui n’est pas celui de l’actualité.
Plutôt que des pressions, ce sont des messages que nous lui transmettons sur des sujets pour lesquels on veut le voir prendre position.
Il ne faut pas oublier qu’à l’époque, Ariel Sharon, Premier ministre d’Israël, avait imposé une sorte de boycott. La France avait une position unique en ayant choisi de garder la relation avec Arafat, qu’elle considérait comme le président élu de l’Autorité palestinienne (AP).
Cette relation a duré deux ans pour moi. Elle avait en toile de fond ma connaissance du monde arabe et le respect d’Arafat pour le “docteur Chirac” et tout le dispositif français.
Il ne faut pas oublier que 2003 est marquée par l’intervention américaine en Irak et le discours de Dominique de Villepin, alors ministre français des Affaires étrangères, qui s’y opposa. Ces deux éléments vont incarner un moment de bascule fondamental dans la région. Arafat l’a très bien senti. Nous étions aussi avec lui dans de l’analyse politique.
C’est un poste compliqué qu’il faut aborder avec rigueur, professionnalisme, concentration, prudence, parfois avec discrétion et dans l’idéal, avec sang-froid. Il faut être sur tous les fronts, très présent à tous et porter une grande attention à ses équipes.
Comment, en tant que représentant de la France laïque, avez-vous appréhendé l’abord d’histoires et de spiritualités millénaires ?
“L’Orient est religieux”, c’est ainsi que je commence le chapitre “Du ciel et de la terre”. Je considère que le fait religieux est une donnée majeure de la vie internationale et que notre sacro-saint attachement à la laïcité doit, pour autant, faire en sorte qu’on prenne cela en compte. Jérusalem nous place devant une réalité qui, certes, est politique mais qui fonctionne aussi avec des éléments spirituels. Le défi est d’arriver à ce que notre correspondance pour Paris ne soit pas déconnectée de tout ça. C’est aussi pour cette raison qu’on est constamment en lien avec les congrégations religieuses, le patriarcat latin, la Custodie, le délégué apostolique. Concernant l’islam, il se trouve que j’ai un parcours qui fait que les choses étaient assez faciles. La relation au monde juif relevait plus de notre ambassade à Tel Aviv.
Vous dites vous être laissé toucher par les messes consulaires. Est-ce en tant que consul ou en tant qu’homme ?
Pour moi, c’était impossible de dissocier les deux. On ne peut pas à mon avis s’en tenir à une attitude purement extérieure et protocolaire. Pour ce poste, il faut une disponibilité personnelle et aimer le monde religieux. Cela va plus loin qu’une curiosité car on est au contact de personnes qui portent un engagement spirituel très fort, celui de leur vie, et pour les Palestiniens, celui de leur identité.

Régis Koetschet avec Yasser Arafat, président de l’Autorité palestinienne, en mars 2003.© Photos Collection Régis Koetschet
Vous partagez dans votre livre que ce fut une chance de travailler avec Mgr Michel Sabbah, alors patriarche latin de Jérusalem. Pourquoi et sur quels sujets particulièrement ?
Michel Sabbah est un homme impressionnant par l’étendue de ses connaissances spirituelles et linguistiques, par la force de ses convictions pour la paix et ceci dans une véritable démarche missionnaire. Doué d’une grande finesse politique, il me parlait avec beaucoup d’intelligence d’Arafat et de ses erreurs, de l’Autorité palestinienne. Il fait partie de ces voix qu’on n’a pas assez entendues ou plutôt voulu entendre, comme si être Palestinien interdisait par nature la sincérité et la pertinence du message.
Vous êtes à l’origine du centre franco-allemand de Ramallah. Pourquoi insistez-vous autant sur la place du culturel dans la diplomatie, en Terre Sainte notamment ?
C’est là où j’ai situé notre vraie contribution au processus de paix en faisant des lieux de culture des lieux où les Palestiniens pouvaient dénouer les nœuds qui sont ceux d’une jeunesse dans un pays en crise, pour mettre leurs énergies au service d’une démarche de dialogue et/ou de création. J’ajoute que dans toute démarche diplomatique il devrait y avoir une dimension culturelle. Il s’agit tout simplement de s’intéresser à la culture des autres, ce qui ne veut absolument pas dire les dominer. Pour moi, c’est une force dans des pays en crise ou en sortie de crise : il faut retisser un tissu social, redonner de la confiance aux gens entre eux, vis-à-vis de nous, de nous vers eux.
Lire aussi >> Le nouveau Consul général de Jérusalem réaffirme l’engagement de la France auprès des chrétiens
Avez-vous des regrets ?
Celui, bien sûr, d’être parti sans avoir vu la paix progresser.
Vous écrivez aussi avoir été en colère, l’êtes-vous encore aujourd’hui ?
La colère est souvent montée devant les aspects de la colonisation et l’érection du mur de sécurité. Aujourd’hui j’ai comme une sorte de vertige. D’un côté, les fondements de la solution à deux États s’éloignent jour après jour ; de l’autre côté, il y a un peuple palestinien parmi les plus cultivés au monde, supposé s’évaporer et qui pourrait pourtant vraiment être un partenaire pour la paix. Au milieu, une ville unique au monde, porteuse de pluralité spirituelle. Et on nous présente tout cela comme une vieillerie du monde d’avant, comme un anachronisme. Mgr Pizzaballa, l’actuel patriarche latin, parle d’un contexte politique et social blessé et diviseur, et appelle à ce que Jérusalem redevienne la Ville sainte, une ville de prière et d’hospitalité ouverte à tous. C’est aussi ce que je pense.
Vous avez quitté votre poste à l’avènement de Mahmoud Abbas. Vingt ans après, quel sentiment portez-vous à la fin de son ère ?
Le système politique est bloqué en Cisjordanie comme à Gaza et n’arrive pas à se régénérer. Les Palestiniens sont gouvernés par des gérontocrates. Le malheur palestinien, c’est ça.
Que pensez-vous des “Accords d’Abraham” ?
Dans le fond je me réjouis de ces accords de reconnaissance. Mais je suis très choqué par cette référence politisée à Abraham. Ces accords relèvent de la géopolitique et non de la religion. Je voudrais cependant qu’ils soient un élément moteur : les pays arabes signataires ont fait un pas important vis-à-vis des Israéliens, cela leur donne des droits pour faire progresser le dossier dans sa globalité, sur Jérusalem et sur les Palestiniens.
À LIRE
Diplomate dans l’Orient en crise – Jérusalem et Kaboul, 2002-2008
Régis Koetschet
Coédition Hémisphères/Maisonneuve & Larose 224 pages – 18€
Dernière mise à jour: 15/05/2024 12:05