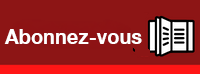En Syrie, les cas de contagion au Covid-19 officiellement recensés sont relativement peu nombreux. Il ne fait aucun doute que les données réelles soient bien différentes dans un pays déjà épuisé par neuf années de guerre. Craintes pour la province d'Idleb.
Début avril, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a envoyé 5 000 tests dans le nord-ouest de la Syrie pour identifier les patients atteints du Covid-19. En collaboration avec certaines organisations médicales syriennes dans les districts nord-ouest d’Idleb et d’Alep, l’OMS a mis sur pied trois hôpitaux à Idleb, Salqin et Darat Izza dans le cadre de l’état d’urgence dû au coronavirus, pour un total de 210 lits.
Dans un pays entré dans sa dixième année de guerre, où les combats depuis mars 2011 jusqu’à aujourd’hui auraient causé au moins 380 000 morts et déplacé plus de 6 millions de personnes à l’intérieur du pays, le coronavirus, avec une trentaine de cas confirmés et deux décès (au 15 avril), risque de déclencher un énième état d’urgence. En Syrie, à peine la moitié des hôpitaux publics sont en activité, pour autant, il y a souvent une pénurie de médicaments et d’équipements. Sans parler des conditions d’hygiène, souvent très précaires.
Pour tenter de contenir la pandémie, le gouvernement de Damas a fermé ses frontières, imposé une distanciation sociale en fermant les écoles et les restaurants, et empêché les gens de sortir de leur province. Autour de Damas, les autorités ont imposé un couvre-feu partiel, en déclarant la mosquée chiite de Sayyidah Zaynab, à la périphérie sud de la capitale, « zone interdite ».
Des doutes sur les chiffres
Face aux mesures prévues, l’incidence déclarée presque sans importance des personnes contaminées et décédées en Syrie à cause du Covid-19 présente cependant plus que quelques points obscurs. Selon les experts, Damas minimiserait le nombre de morts pour des raisons politiques. « Le personnel médical pense que de nombreuses personnes meurent en Syrie à cause du virus », explique Zaki Mehchy, analyste au prestigieux centre d’études de Chatham House à Londres. Il y aurait cependant un « ordre de la sécurité nationale » de garder le silence sur ce qui s’est passé.
La crainte, de la part des militants des Droits de l’homme et des agences humanitaires, est qu’une autre catastrophe puisse être vécue dans le silence général, notamment parce que le système de santé syrien ne semble pas être en mesure de traiter les patients atteints par le virus. Selon l’OMS, au moins 70% des médecins et des infirmières auraient fui depuis le début de la guerre.
La fragilité d’Idleb
Les zones les plus menacées du pays sont celles du gouvernorat d’Idleb, où une trêve est en vigueur depuis le 5 mars, mais où des poches de territoire sont contrôlées par les forces rebelles alliées de la Turquie et hostiles à Damas. La distance sociale et l’assistance médicale, en particulier dans les camps de réfugiés qui abritent près d’un million de personnes, sont pour le moins impensables.
« Le manque de nourriture, d’eau potable et l’exposition au froid ont déjà affecté des centaines de milliers de personnes, les rendant encore plus vulnérables », déclare Misty Buswell de l’ONG International Rescue Committee (IRC). Selon les données de l’ONG (qui met également en garde contre une réduction de l’aide humanitaire au pays), la quasi-totalité des 105 lits de soins intensifs et des 30 respirateurs des hôpitaux d’Idleb sont déjà utilisés pour d’autres maladies.
Le virus et la propagande
Finalement, les craintes qu’une nouvelle menace plane au-dessus de la Syrie sont réelles, compte tenu également de l’instrumentalisation politique que les parties concernées font de la pandémie. D’une part, l’Etat islamique qui présente le virus comme une punition divine et incite les adeptes à se joindre à la lutte djihadiste. D’autre part, le gouvernement de Damas, qui voit dans la gestion (manipulée ?) de l’épidémie la possibilité de réaffirmer son efficacité et son image au niveau international.
Dans les deux cas, malheureusement, utiliser la pandémie à des fins politiques en jouant avec la peau de millions de personnes pourrait avoir des répercussions catastrophiques.