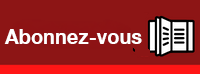Quand un journaliste vit son premier Noël à Bethléem une année de pandémie

Terre Sainte Magazine compte une nouvelle plume, Samuel Forey. Ce reporter de guerre vient de poser ses valises à Jérusalem et son premier reportage est... un Noël à Bethléem, une année pas comme les autres et pour lui un Noël pas comme les autres. Récit.
Les fanfares scoutes défilent, en grand uniforme, drapeaux déployés, chemises repassées, jambières immaculées, dans la rue de l’Etoile. Les cornemuses et clarinettes, cors et trompettes résonnent puissamment dans l’étroit passage qui mène à la basilique de la Nativité, érigée au-dessus de la grotte où, selon la tradition, le Christ est né. Elles arrivent sur la place de la Mangeoire, le centre de Bethléem, où elles… repartent pour un tour, car au lieu de venir du pays entier, seuls dix groupes ont été admis à parader cette année, à cause de l’épidémie de Coronavirus. Au fracas des cuivres et des tambours, les spectateurs donnent une réponse discrète, comme s’ils n’osaient manifester trop leur enthousiasme ; comme s’ils hésitaient entre se réjouir et se lamenter, étonnés d’être là, dehors, sous la pluie — alors qu’il ne pleut presque jamais à Bethléem, à Noël —, au plus fort de la pandémie, rassemblés malgré tout, même si peu nombreux — à peine quelques centaines au lieu des nombreux milliers, qui furent la règle des dernières années.
Personne dans cette foule ne se souvient d’une année sans pèlerins dans la ville. J’ai demandé autour de moi ces derniers jours, à des historiens, à des spécialistes. Je n’ai reçu aucune une réponse claire. Même quelques courageux sont venus en 2000, pendant la deuxième intifada. Mais avant ? Pendant les deux guerres mondiales ? Et encore avant, à l’époque ottomane ?
« Je suis heureuse de venir, mais triste de voir si peu de gens. On a tous peur de tomber malades. Nous avons été très durement touchés par l’épidémie, en Palestine », dit Samar Imbassala, une chrétienne orthodoxe de la ville, parapluie en main, manteau sur le dos, et masque soigneusement posé sur le visage. « Normalement, il fait beau, et la place est noire de monde. Tout Bethléem vibre autour de Noël. Sauf cette année », reprend-elle. Elle est venue avec trois autres amis, et le petit groupe reste près des barrières, tout en s’isolant des autres personnes, dans l’art de la distanciation sociale que le monde entier apprend sur le tas.
Le patriarche apparaît soudain sur la place, salue la foule et, sans tarder, file vers la petite porte de la basilique de la Nativité, où il est accueilli, à 14 heures précises, par les représentants arménien, grec et latin, communautés responsables gardiennes du lieu saint. Le site est vénéré depuis les débuts du christianisme. La première basilique est construite sur ordre de Constantin, après la visite qu’y fait sa mère, Hélène, en 325. Détruite par les révoltes des Samaritains en 529, elle est reconstruite sous Justinien, et n’a guère changé depuis. Elle a été épargnée par les Perses en 614 — ils avaient pris les représentations des rois mages comme celles de prêtres zoroastriens —, puis par les Arabes, a été sauvée de justesse sous les Fatimides — contrairement à la basilique du Saint-Sépulcre, abattue sur ordre du calife Al-Hakim —, fut retouchée par les Croisés, intouchée par Saladin, négligée par les ottomans, parvenue jusqu’aujourd’hui, embellie par une récente restauration.
C’est la première entrée de Pierbattista Pizzaballa en tant que patriarche latin de Jérusalem dans la basilique. Jusqu’au bout, sa venue était incertaine. Lui-même atteint par le virus au début de ce mois, il a dû naviguer ferme, le patriarcat étant pris dans les vents contraires des contraintes sanitaires des autorités israéliennes comme palestiniennes. Il a été décidé d’une cérémonie très restreinte, avec deux cents invités à la messe proprement dite, au lieu des deux mille habituels.
L’évêque se courbe pour passer sous le seuil des 1,50 mètre — la hauteur la été réduite à l’époque ottomane — pour aller tout de suite à gauche, dans l’église latine de Sainte-Catherine, accolée à la Nativité — il passe du lieu saint au lieu de culte. Les Vêpres débutent.
« C’est la pandémie qui commande, pas nous. Nous avons dû nous résoudre à limiter le public, malgré la catastrophe économique — 80% de la population dépend du tourisme ici, directement ou indirectement. Pour la première fois de ma vie, je vois la Nativité vide à Noël », soupire Vera Baboun, l’ancienne maire de Bethléem.
L’événement, qui touche le public, n’épargne pas les prêtres. Les vêpres terminées, ils vaquent dans le couvent, au lieu d’être affairés de tous côtés. On ne sait pas quoi faire — la rumeur court que le patriarche se rendra au Champ des Bergers, là où des milliers les fidèles de tous les pays, qui n’ont pu accéder à la messe de minuit, assistent à des messes nocturnes. Finalement, non. Peut-on sortir, même ? Pas sûr — l’ambassadrice américaine aux Nations-Unies, Kelly Knight Craft, est présente avec sa famille et ses gardes du corps, toutes oreillettes dehors. Je peux sortir, mais ne suis pas sûr de rentrer à nouveau. Je n’arrive pas à comprendre à quelle heure le patriarche descendra dans la grotte, et demande à un prêtre qui passe par là.
Le Frère Stéphane Milovitch me répond, et je n’aurais pas pu mieux tomber. C’est l’ancien gardien de la basilique de la Nativité à Jérusalem, et met des mots sur les gestes, et des significations dans les rituels. Grand, il termine parfois ses phrases par des silences interrogateurs, auxquels on se sent obligé de répondre à une question qui n’a pas été posée.
Le patriarche descendra à 16 heures pour la messe de Noël. On m’avait dit qu’elle était célébrée tous les jours, ce que je ne comprenais pas — mais le frère Stéphane m’explique que c’est dû au lieu. A Bethléem, on commémore l’événement de la naissance du christ tous les jours, car c’est ici même que, selon la tradition chrétienne, elle s’est produite. Ailleurs, on célèbre la nativité une fois par an — au moment de l’événement. Mais ce soir, à Bethléem, le spatial coïncide avec le temporel — « comme une croix », explique limpidement le frère Stéphane, et j’imagine une carte avec une croix dessinée à l’intérieur de la basilique, et je comprends mieux le caractère exceptionnel de la cérémonie de ce soir.
La voilà qui recommence, et le patriarche guide la procession dans la grotte sombre, au rythme des psaumes en latin. L’assemblée réduite donne plus de place à chaque geste — rien d’autre que la liturgie, dans l’air épaissi par les fumées d’encens, entre les murs étroits drapés de velours bleus, comme si la cérémonie revenait à son essence. Et les Franciscains, à la nuit où François d’Assise reconstitua une crèche vivante à Greccio, en 1223 — et où dit-on, l’enfant Jésus apparut… « On est au-delà d’une représentation. Ici, on rend présent l’événement que l’on célèbre », insiste le Frère Stéphane.
« Joyeux Noël… Triste Noël », soupire encore l’ancienne maire de Bethléem en sortant de la grotte. Etonnant Noël, aussi, où les prêtres flânent ici et là, se taquinent et discutent en italien, arabe, anglais et, parfois, français. Je croise un prêtre originaire d’Irak et nous parlons brièvement de Mossoul, où se tient en ce moment même, dans l’église Saint-Thomas, la première messe de Noël depuis la prise de la ville par les djihadistes de l’Etat islamique, en 2014.
« On vient de partout pour servir en Terre sainte », dit Stéphane Milovitch, ce qui fait parfois des dîners animés, qui profite de son temps libre pour faire visiter un site exceptionnel, de la grotte aux toits, les trésors et les secrets d’une basilique dont la fondation remonte au IVe siècle à l’église Sainte-Catherine, construite au XIXe siècle — un « sanctuaire bipolaire », qui fait cohabiter lieu saint et lieu de culte, partagé par les autres communautés, partageant une même foi, exprimée selon différentes cultures. Le frère Stéphane voit la cohabitation des différentes Eglises autour de la Basilique de la Nativité, le véritable lieu saint, comme des planètes qui tournent autour du soleil. Latins, Grecs, Arméniens, les uns et les autres font vivre la grotte depuis des centaines d’années.
Il m’emmène sur le toit de l’église Sainte-Catherine. Collée à la basilique, l’endroit permet d’observer la courbure idéale des absides de la nef construite à l’époque de Justinien — et je réalise qu’à part le monastère Sainte-Catherine, bâti sur ordre du même Justinien dans le Sinaï, je n’eus que rarement l’occasion de contempler des édifices byzantins.
Toujours sur le toit, nous contournons le transept nord et longeons la nef. Point de voûte ici, mais murs et poutres — le dessin m’évoque celui des églises arméniennes encore debout, que j’avais vues dans le sud-est de la Turquie en 2015, et qui m’étonnaient tant — et je comprenais c’était ça, le répète qui me manquait : la voûte, invention latine. L’élégance simple des fenêtres de la basilique me paraît étonnamment moderne — alors que c’est plus beaucoup plus ancien que ce que je connais habituellement.
Nous passons du toit à la grotte. On y descend par un escalier étroit, qui date de l’ère de Justinien. Sur le lieu même de la naissance, une reproduction de l’étoile d’argent latine, dont le vol en 1847 avait abouti à la guerre de Crimée — et de l’autre côté, la mangeoire ou sera déposé la figurine représentant l’enfant Jésus, tout à l’heure, à l’issue de la messe de Minuit. C’est une petite cavité étroite, avec des tableaux grecs et arménien, sombre, et une tenture offerte par le président français Mac Mahon. Justinien n’aimait pas cette grotte nue, selon le frère Stéphane, et y fit encastrer une petite chapelle. Il m’emmène dans la partie nord de la grotte, avec une autre crypte, et un autre hôtel — surplombé par un étonnant Christ de fer forgé du XXe siècle.
« Je veux juste montrer que c’est un lieu cohérent. Marie, sur le point d’accoucher, ne peut rester dans l’auberge. Le soir, dans le froid, ils cherchent un endroit où s’abriter et découvrent cette grotte. Elle ouvre au nord (et il me montre l’ouverture originelle, murée depuis longtemps). Je crois qu’une mère sur le point d’accoucher cherche l’endroit le plus abrité et le plus éloigné de l’entrée, pour échapper aux regards, aux vents froids. » Dans un puits, on a retrouvé des vestiges alimentaires de l’époque hérodienne. Ce lieu a été vénéré dès le Ier siècle — et fut transformé en un temple consacré à Adonis, sous l’empereur Hadrien. Celui-ci tient compte de l’histoire du lieu.
On remonte dans la basilique. Il me montre d’autres trésors, me fait revoir la fonction de l’iconostase, ce mur d’icônes derrière lequel est célébrée la messe, qui fait écouter plutôt que voir. Toute cette visite se fait dans une solitude exceptionnelle le soir de Noël — pas de pèlerins, pas de touristes, pas de foule empressée.
Le dîner est simple, cette année. Le président de l’autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, n’est pas venu, simplifiant d’autant les contraintes sécuritaires.
Pause jusqu’à la messe de minuit. Je reviens sur le toit de l’église Sainte-Catherine, pour remettre de l’ordre après la longue discussion avec le frère Stéphane, qui m’a emmené beaucoup plus loin que je ne le pensais. Sous les étoiles, dans le froid perçant de l’hiver en Palestine, je revois la basilique de la Nativité — et une fois de plus, son élégance épurée. Je n’aurais pu songer mieux pour ma première messe de Noël à Bethléem.
Je reviens dans la grotte, puis dans la nef, refaisant le même chemin que tout à l’heure, plus contemplatif — plus silencieux. Depuis quinze ans que je viens dans la région, en tant qu’étudiant, visiteur, puis journaliste, je ne cesse de découvrir, plus en profondeur, et ne cesse de m’étonner des richesses que je contemple — quand celles-ci ne sont pas réduites en ruines fumantes. La basilique de la Nativité est une survivante.
Comme dans un rêve, on glisse jusqu’à la messe de minuit. Les Franciscains font leur entrée en soutane blanche avec le patriarche, qui bénit les fidèles présents, guère nombreux — maximum trois par banc, et tous ne sont pas remplis, dans cette église de taille modeste où normalement, l’assemblée assiste debout à cet événement.
Cette fois-ci, seuls sont venus ceux qui vivent ici, en Israël. Roberto Adaro, un Argentin travaillant à Jérusalem, venu avec sa femme et ses trois enfants : « C’était très important pour moi de venir, surtout cette année. Il faut savoir s’adapter, et ceux qui voient cette messe à la télé peuvent se dire qu’ils viendront l’année prochaine. »
C’est ainsi que le patriarche commence la messe de minuit : « Frères et soeurs, nous sommes peu nombreux ce soir, mais vous représentez ceux qui ne peuvent être là. » Dans son homélie, alors que la crise de la pandémie est peut-être à son faîte, Pierbattista Pizabballa dit : « La nuit, n’importe quelle nuit, n’est pas le dernier mot de notre histoire et de l’humanité. »
George Handal écoute en silence, à l’arrière, élégant, dans son long manteau. Ce Palestinien de Bethléem assiste pour la première fois de sa vie à la messe de minuit, à 55 ans. « Habituellement, on laisse la place aux pèlerins. C’est un peu notre tour maintenant ! C’est notre chance… Et c’est une très grande joie, pour moi », confie-t-il. Il visite la grotte, voit l’enfant Jésus tout juste déposé par les Franciscains. L’assemblée des latins partis, les moines grecs orthodoxes encensent les lieux, comme pour les rendre à leur état originel, alors qu’à côté, un prêtre arménien célèbre une messe de sa voix profonde. La basilique de la Nativité est rendue à sa solitude et Bethléem, à son silence.