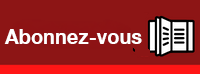Parler une langue, c’est bien autre chose qu’apprendre les pages d’un dictionnaire, ou ingurgiter à coups d’heures studieuses le contenu d’une grammaire aride. Parler une langue, c’est entrer dans une autre culture, une psyché différente. Pour se rendre compte, parfois, qu’elle n’est pas si éloignée de la sienne. Et au final, courir le risque de réellement rencontrer l’autre. Tout sauf une démarche anodine, surtout sous la lumière crue de Jérusalem. Portraits croisés de deux parcours singuliers, donc universels.
Dans cette région du monde où tout est inflammable, cet article aurait dû faire office de bonbon gentiment sucré, débuter sur un ton guilleret, se poursuivre itou, se conclure idem.
On imaginait déjà les photos de nos deux témoins côte à côte, façon générique d’Amicalement vôtre. À droite, une Palestinienne chrétienne de Jérusalem-Est ; à gauche, un Israélien juif de Jérusalem-Ouest. Les deux étaient nés, pur hasard, la même année – 1982. Les deux avaient en commun d’avoir décidé d’apprendre la langue de l’autre : hébreu pour elle, arabe pour lui. Les deux étaient d’accord pour expliquer leur démarche.
Mais voilà qu’arrivent Beer Sheva, Hadera, Bnei Brak : trois villes, trois attentats meurtriers commis entre les 22 et 29 mars pour terroriser la population juive israélienne alors que se tenait, les 27 et 28 mars, un sommet entre Israël, quatre pays arabes et les États-Unis dans le Néguev. Et les morts palestiniens qui se multiplient, aussi, en Cisjordanie – 3 membres du Jihad islamique tués le 2 avril, 2 Palestiniens tués dans une fusillade avec l’armée israélienne le 31 mars… De quoi raviver l’angoisse sempiternelle en période de Ramadan : 2022 serait-elle aussi terrible que 2021 et ses 11 jours de conflit entre Israël et le Hamas ? la question tournait dans les têtes.
Apparaît alors la première différence flagrante entre nos deux témoins : tandis qu’à Jérusalem-Ouest, Yonatan considère important de témoigner, notre interlocutrice palestinienne ne se sent plus à l’aise à l’idée que son nom, son visage s’affichent pour expliquer pourquoi, à 40 ans, elle s’est décidée à apprendre sérieusement une langue qu’elle entend depuis sa prime enfance. La crainte du qu’en-dira-t-on, la peur que son fils adolescent, qui tous les jours se rend de Jérusalem-Est, où il habite, à Jérusalem-Ouest, où il étudie, ne subisse des comportements hostiles. Alors elle demande finalement à rester anonyme : ni nom, ni visage, rien qui l’identifie. Mais ses mots resteront, trop précieux pour être engloutis par les énièmes troubles dans la région.
Démarche est – ouest
La quarantaine, donc, c’est l’âge qu’aura attendu notre interlocutrice pour se lancer, apprendre vraiment l’hébreu. Car elle est née ici, a grandi à Sheikh Jarrah, ce quartier de Jérusalem-Est si médiatisé ces dernières années, sur fond d’expropriations de Palestiniens au profit de colons juifs ; c’était alors, dit-elle, du temps de son enfance, “un quartier si beau, si paisible”. Elle n’y habite plus mais n’est pas partie bien loin, du côté de cette Porte de Damas qui cristallise elle aussi nombre de tensions. On parlait arabe à la maison. Depuis, tant d’autres langues apprises : un français et un anglais impeccables, l’espagnol aussi. L’hébreu, qui résonne partout autour d’elle, tous les jours ? Elle le comprend à peu près mais ne peut le parler, car elle ne l’a jamais appris sérieusement à l’école. Les élèves n’en voyaient pas l’intérêt, dit-elle : pourquoi faire l’effort d’apprendre une langue parlée dans un seul petit pays, quand l’arabe, l’anglais et le français ouvrent tant de portes ?

De nombreux Palestiniens de Jérusalem choisissent les bancs de l’université hébraïque pour poursuivre leurs études en langue hébraïque. Elle leur offre des domaines d’apprentissage inexistants dans les facs palestiniennes. © Miriam Alster/FLASh90
Un blocage lié à la situation politique, aussi ? Non, répond-elle du tac au tac, évoquant sa “famille très ouverte, on ne parlait pas politique à la maison. C’est vrai que je n’avais pas d’amis juifs mais je ne crois pas que le fait que je n’ai jamais appris l’hébreu soit lié à cela ; on n’en avait pas besoin, tout simplement”. La conversation continue, et puis, ce souvenir : “mais c’est vrai, il y a quand même peut-être quelque chose, sur le thème du blocage. J’ai commencé l’université lors de la seconde Intifada. Tous les jours j’allais de chez mes parents à Sheikh Jarrah, à l’université de Bir Zeit, en Cisjordanie. Trois check-points aller, trois check-points retour. C’est dans ce contexte que j’entendais l’hébreu, dans la bouche des soldats israéliens. Une langue qui me paraissait si dure. Quand j’y pense, je l’ai quasiment toujours entendue dans un contexte militaire.”
“depuis que j’apprends l’hébreu, avec deux professeures israéliennes juives, je me rends compte que cette langue peut être plus douce, moins agressive sortie de son contexte militarisé. Et je suis moins heurtée lorsque je l’entends désormais autour de moi, dans la rue, dans le tram”.
Quel déclic alors, pour prendre des cours ? La nécessité : car notre interlocutrice, multi-diplômée, veut suivre une formation autour des langues et cultures du Proche-Orient. Dans ce cadre, pas question de se contenter de comprendre ses interlocuteurs en hébreu sans pouvoir leur répondre – c’était son cas jusqu’à présent, au point que cette native de Jérusalem s’adresse en anglais aux vendeurs dans les boutiques de sa ville lorsqu’ils ne parlent pas arabe. Si elle n’a pas besoin de l’hébreu pour trouver un emploi, c’est donc bien par nécessité, tout de même, qu’elle a décidé de franchir le pas, rejoignant en cela nombre de Palestiniens et Palestiniennes qui ne peuvent prétendre à certains postes sans la maîtrise de cette langue, signe du pouvoir économique exercé par Israël dans la région.
Mais nécessité ou pas, les effets de l’apprentissage de la langue vont bien au-delà de l’utilitaire : car, nous dit-elle aussi, “depuis que j’apprends l’hébreu, avec deux professeures israéliennes juives, je me rends compte que cette langue peut être plus douce, moins agressive sortie de son contexte militarisé. Et je suis moins heurtée lorsque je l’entends désormais autour de moi, dans la rue, dans le tram”.
À deux kilomètres de là
Jérusalem-Ouest, quartier Rehavia. Soit l’un des quartiers huppés de Jérusalem, longtemps peuplé par l’intelligentsia ashkénaze traditionnellement aux manettes en Israël. Certains se souviennent encore de Golda Meïr, Première ministre, déambulant dans ses rues ombragées. C’est au cœur de ce quartier, dans la rue Azza, nom hébreu de Gaza, que Yonatan Vadai – dit Yoni – a ouvert deux bars-restaurants : Carousela d’un côté de la rue, Bab El Yaman – Porte du Yémen – de l’autre. Un nom qui ne doit rien au hasard : si Yoni est né ici, ses deux parents sont venus du Yémen en 1949, juste après la création de l’État. Les deux parlaient arabe et hébreu : pour que leurs cinq enfants, tous nés en Israël, s’intègrent, ils choisissent de ne leur inculquer que l’hébreu. Yoni a certes entendu le son du dialecte arabe yéménite à la maison, dans la bouche de sa grand-mère notamment, mais il se souvient surtout de ses parents ne l’employant entre eux que quand ils voulaient être sûrs de ne pas être compris de leurs enfants.
Lire aussi >> Quand les chrétiens faisaient la grandeur de la langue arabe
À la fin du lycée, comme tous ses condisciples, Yoni savait qu’il partirait au service militaire. C’est à cette période, vers 16-17 ans, qu’il décide d’apprendre des rudiments d’arabe, “seul, avec des livres”. L’envie de partir à la découverte de ses racines ? Pas du tout, nous coupe-t-il : “J’étais très nationaliste, je voulais défendre mon pays, et je pensais qu’apprendre l’arabe me permettrait de le faire d’autant mieux, en étant utile à l’armée”. Suivent trois ans de service militaire, en pleine seconde Intifada. Alors que notre interlocutrice palestinienne entend l’écho des ordres donnés en hébreu aux check-points, Yoni balaie ces trois années d’une formule pudique : “On voit beaucoup de choses dans ces moments-là, beaucoup… ça a changé ma vision des choses”.

© Sophie Gordon / Flash 90
Là où d’autres sont revenus plus durs, lui décide à la fin de son service d’approfondir sa connaissance de la langue arabe et de sa culture – yéménite avant tout, mais “pas que, poursuit-il, toutes les cultures arabes m’intéressaient”. Il prend alors des cours particuliers de fusha (prononcer fusse ha avec h aspiré), l’arabe moderne standardisé, ouvre Carousela en 2009, Bab El Yaman une dizaine d’années plus tard. Il en fera des lieux privilégiés de diffusion des langue et culture yéménites en particulier, arabes en général. Des ponts jetés entre les populations, espère-t-il. Ce n’est d’ailleurs pas anodin si figure à la carte de Carousela la Taybeh – une bière palestinienne qui lui a déjà donné l’occasion d’entendre des passants maugréer qu’ils n’iraient pas dans ce café où l’on sert une “bière de gauchiste”. Mais Yoni n’en a cure ; plutôt que de s’appesantir sur les crispations qu’il a devinées au début dans le regard de certains riverains du quartier, il note le succès de ses soirées yéménites, y compris désormais parmi ses voisins ashkénazes. Et se dit confiant dans le fait “qu’aujourd’hui, ceux qu’on appelle les mizrahim, les juifs originaires de pays arabes, et notamment la troisième génération, n’ont plus honte de ce qu’ils sont, de leur apparence, de leur culture, de la langue arabe. Il y a un vrai mouvement de renaissance” dit-il en employant le mot en français. Or, conclut-il, “lorsqu’on se comprend, on a moins peur”.
Dernière mise à jour: 01/05/2024 11:37