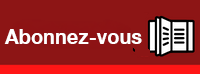L’une travaille en indépendante, l’autre dirige un centre dont
la vocation est le dialogue judéo-chrétien.
Toutes les deux, juives israéliennes, se sont fixé pour tâche de faire connaître le christianisme à leurs compatriotes. Rencontre avec Yisca Harani et Hana Bendcowsky.
De son index tendu, Yisca Harani désigne le carré de la fenêtre, derrière notre dos. Carré gris, le ciel d’hiver est maussade aujourd’hui sur Jérusalem, mais depuis cette petite salle de classe d’un bâtiment du Jerusalem University College, perché sur le mont Sion, les nuages et le mauvais temps ne suffisent pas à masquer la tour du YMCA (Young Men Christian Association). Elle se découpe au loin, pierre blonde sur ciel palombe, son sommet arrondi reconnaissable entre tous. “La voilà, expose Yisca Harani, la première explication de mon intérêt envers le christianisme. Je suis née en 1961, à Jérusalem, dans une famille juive, et à l’époque, il y avait une seule piscine digne de ce nom ici. Celle du YMCA. Ma mère m’y conduisait trois fois par semaine. Là, vous trouviez des arabes, des arméniens, des juifs… ; j’ai grandi de façon très naïve, en pensant que la coexistence des communautés allait de soi. J’ai retenu de cette époque que Jérusalem était une partition pour plusieurs instruments.” Sur les fondations de cette enfance, parvenue à l’âge adulte, Yisca Harani va peu à peu s’édifier en pont entre les deux religions, judaïsme et christianisme. Cela commence par des visites guidées à Nazareth, cela se poursuit, en dehors de toute attache universitaire fixe – “je suis indépendante, j’y tiens !” – avec des séminaires, des conférences, des prises de parole désormais suivies par plusieurs centaines de personnes, parfois plus d’un millier. “La semaine dernière, à Tel Aviv, ma conférence sur le thème “Visiter la Terre Sainte avec la Bible hébraïque et le Nouveau Testament” a été suivie par plus de 400 personnes”, détaille-t-elle, se réjouissant de l’intérêt porté par des juifs israéliens à un thème extrêmement méconnu, et perçu même comme provocant par bon nombre. “Le christianisme fait peur”, explique Yisca Harani. “Lorsqu’en tant que juif parlant à d’autres juifs, vous expliquez que vous vous y intéressez, vous suscitez très souvent cette réaction. Pourquoi t’intéresses-tu à cette religion qui a voulu nous éradiquer ? C’est cela que vous entendez ou ressentez.” Une attitude qu’elle-même, forte de son enfance, combat : “Lorsque tu es ferme dans ta propre foi, tu n’as pas à avoir peur de la religion de l’autre”. D’autant qu’elle explique avoir trouvé dans l’étude du christianisme des sources d’approfondissement de son propre judaïsme. “Un exemple, dit-elle : je suis fascinée par le concept chrétien de péché. Je trouve passionnant de le mettre en regard de ma religion, qui me fait réciter chaque matin le Elohaï Neshama, prière dans laquelle le croyant remercie Dieu d’avoir instillé en lui une âme pure. Quelle différence de perspective sur la base de textes pour partie identiques !”
Quand la religion éclaire le politique
Cet enrichissement mutuel entre deux cultures est également ce qui a conduit Hana Bendcowsky à s’intéresser au christianisme. Les chemins pour y parvenir n’étaient pas directement tracés pour celle qui dirige aujourd’hui le Centre pour les Relations Judéo-Chrétiennes de Jérusalem. Contrairement à Yisca Harani, Hana Bendcowsky n’est pas née à Jérusalem mais dans le centre d’Israël, où les identités religieuses sont moins multiples que dans la ville trois fois sainte. Issue d’une famille “orthodoxe moderne”, elle confie que tout en baignant dans une tradition juive, “on n’était pas très strict sur les règles religieuses à la maison”, une famille “libérale”, “pas très intellectuelle” non plus, dans le sens où, précise-t-elle, “on ne réfléchissait pas tellement aux questions de foi, de culture”. Cette réflexion-là viendra un peu par hasard : après ses deux années réglementaires de service militaire (en Israël, les jeunes femmes effectuent un service de deux ans, les jeunes hommes de trois), puis la traditionnelle année sabbatique que s’accordent généralement les jeunes Israéliens démobilisés, elle se lance dans des études d’histoire à l’Université hébraïque à Jérusalem. Un cours obligatoire d’introduction au christianisme figure au programme. Le contenu est basique mais c’est le déclic : Hana Bendcowsky y découvre la richesse d’une religion lui permettant de mieux comprendre “tout un pan de l’histoire mondiale, locale, mais aussi de la culture – littérature, peinture, films…”. Elle veut aller plus loin, participe à un groupe de discussion interreligieux. “Il y avait là des juifs israéliens, des chrétiens, palestiniens et étrangers, les discussions étaient très riches, et m’ont confortée dans mon envie de mieux connaître le christianisme, qui me permettait, tout en m’ouvrant à d’autres réalités et perspectives sur le monde, de mieux réfléchir à ma propre culture”. Hana continuera logiquement ses études en “Religion comparée” (“Comparative Religion”). Tout comme Yisca Harani, Hana Bendcowsky rapporte la peur qu’elle a rencontrée alors dans les yeux et les paroles de ses interlocuteurs juifs, lorsqu’elle expliquait son objet d’étude. “Il y avait, il y a toujours en Israël, une grande ignorance du contenu du christianisme, et de son histoire. C’est une ignorance parfaitement volontaire, idéologique, liée à cette peur profonde”.
En faisant fi de cette peur culturelle, Hana explique avoir fait bien plus qu’accumuler une connaissance encyclopédique : car au fil des rencontres, des apprentissages, elle découvre aussi cette réalité qui lui paraît désormais évidente, et pourtant ignorée selon elle par bon nombre d’Israéliens : “Les chrétiens, ici, sont majoritairement palestiniens ! Cela paraît aller de soi pour qui connaît la Terre Sainte, mais demandez à un Israélien lambda qui sont les chrétiens dans le pays : il vous répondra à coup quasi sûr que ce sont des Français, des Américains, etc. certainement pas des Palestiniens ! Quant à ce qu’il sache que la communauté chrétienne compte aussi des russophones, des demandeurs d’asile africains, des travailleurs immigrés asiatiques, il ne faut pas trop y compter.”
Du dialogue interreligieux à une conscience aiguë des enjeux politiques et sociaux auxquels sont confrontées les différentes populations vivant sur un même territoire, il n’y a donc qu’un pas, et sur ce bout de terre où les identités entremêlent si aisément nationalité et religion, Hana Bendcowsky s’investit chaque jour, en transmettant sa connaissance du christianisme à des enseignants, des guides, toute personne désireuse d’en savoir plus, afin, dit-elle, que les juifs israéliens cessent d’avoir peur du christianisme. Afin surtout, martèle-t-elle, que ses interlocuteurs prennent conscience que “nous ne sommes pas, nous, juifs, en minorité dans ce pays. Nous sommes en position surplombante. À ce titre, il en va de notre responsabilité, en tant que majorité, de protéger les minorités potentiellement menacées. Or, ici, les musulmans protègent leurs lieux de culte, avec force. Mais les chrétiens, eux ? On ne les entend pas, ou si peu ! Alors c’est à nous, majorité, d’assurer leur protection ! Il faut que nous abandonnions la mentalité minoritaire dans un pays où nous sommes à l’évidence la majorité aux manettes”.
Sans cesse sur l’ouvrage
La colère affleure sous les mots, on sent Hana Bendcowsky profondément préoccupée, et cette colère fait largement écho à celle de Yisca Harani. Là-bas, sur le mont Sion, avant d’évoquer la genèse de son engagement dans cette petite salle de classe, elle a passé la matinée à organiser des visites guidées dans le cimetière protestant adjacent. Quelques semaines à peine auparavant, début janvier, deux adolescents juifs, âgés de 14 et 18 ans, y ont vandalisé une trentaine de tombes. En 2013, le même cimetière avait fait l’objet d’actes semblables, et c’est précisément ce qui avait mené Yisca Harani à organiser des actions à cet endroit. Nettoyage et remise en état de tombes, visites guidées, conférences. “J’aimerais consacrer tout mon temps à étudier, transmettre, agir positivement… Au lieu de ça, la moitié au moins de mon temps est occupée à tenter d’éteindre des braises que d’autres attisent”. D’autres ? “Les nationaux-religieux. Ces gens qui suivent Itamar Ben Gvir (ndlr : figure de l’extrême-droite israélienne, actuel ministre de la Sécurité nationale). Il fut un temps où ils étaient peu nombreux, se faisaient discrets. Mais aujourd’hui les digues ont cédé, ils ont le sentiment qu’ils peuvent tout dire. Tout faire.” Et de conclure, consciente de la force de ses mots : ici, désormais, “c’est une war zone”. Une zone de guerre. ♦