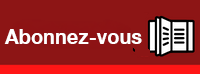La seule université catholique des Territoires palestiniens a été fondée en 1973. La professeure Muna Matar, proche collaboratrice du recteur, raconte l’impact de la guerre entre le Hamas et Israël sur la vie de l’université, sans oublier les motifs de satisfaction.
« Lorsque la guerre a éclaté, en octobre (2023), le semestre ne faisait que commencer. C’était horrible : nous venions juste d’accueillir les nouveaux étudiants, d’entamer les cours, il y avait l’enthousiasme qui accompagne toujours un nouveau départ, et soudain tout a été bloqué et fermé. Grâce à l’expérience acquise il y a quatre ans avec le Covid-19, nous sommes immédiatement passés à l’enseignement à distance et au travail à domicile. Aujourd’hui, après neuf mois, nous essayons autant que possible de rester proches de la population de Gaza et nous espérons que cette tragédie prendra fin. »
Après le Covid, le traumatisme d’une nouvelle guerre
Ainsi s’exprime la professeure Muna Matar, 64 ans, professeure émérite de Sciences informatiques à l’Université de Bethléem et actuellement bras droit du recteur pour les Affaires académiques, alors que devait se dérouler la session de remise des diplômes pour plus de 750 étudiants parmi les 3 078 inscrits en 2024 à l’université. La session était prévue pour les 11 et 12 juillet et a été reportée en raison de la guerre : « Bien que ce soit l’un des moments les plus rigoureux et solennels de la vie universitaire, la remise des diplômes est avant tout une fête. Et il n’y a rien à célébrer en temps de conflit. Nous avons ouvert plusieurs cours en ligne, dont celui d’obstétrique et d’infirmerie, pour une centaine d’étudiantes de Gaza afin qu’elles puissent suivre à distance, comme l’a demandé notre ministère de l’Éducation à toutes les universités palestiniennes. Les cours sont enregistrés, afin que chacun puisse en bénéficier quand il le peut. Nos cours et professeurs de Services sociaux gardent également les lignes ouvertes avec la population de Gaza : ne serait-ce que pour fournir écoute et soutien psychologique. Nous essayons, avec le téléphone et Internet, d’être le plus possible proches et d’apporter l’aide que nous pouvons, en attendant que tout cela prenne fin.»
Lire aussi >> Mouna Maroun: « Les universités israéliennes sont des vecteurs de mobilité sociale »

La professeure Muna Matar. ©Université de Bethléem
La guerre, ajoute Matar, a eu un impact dévastateur sur la vie universitaire déjà éprouvée par l’occupation. «Depuis de nombreuses années, comme chacun le sait, la mobilité est bloquée dans les Territoires : nous sommes à seulement 8 kilomètres de Jérusalem – rappelle l’universitaire – et nous ne pouvons pas y aller ; nous sommes à une heure de la mer, et ma petite-nièce de 6 ans n’a jamais pu la voir. Les checkpoints [de l’armée israélienne – ndlr] sont installés de manière arbitraire à tout moment, de nombreux étudiants ont été arrêtés sans raison. Après les premiers mois où tout était fermé, il nous a été permis de reprendre progressivement les cours en présentiel et aujourd’hui nous sommes en mode mixte. Cependant, la guerre a causé la perte de travail pour de nombreuses familles, qui depuis neuf mois sont sans salaire et ne peuvent payer les frais de scolarité ; sans ces frais, nous avons du mal à payer les salaires de nos employés et enseignants. Nous avons activé des services de conseil, mais il est clair que nous sommes dans un cercle vicieux qui doit cesser.»
Lire aussi >> L’école d’Acre et son engagement quotidien pour éduquer à la coexistence
Une vie à l’université
Muna Matar s’est inscrite à 17 ans à la faculté de Mathématiques de l’Université de Bethléem, seulement trois ans après la fondation – en 1973, à l’initiative du pape saint Paul VI – de la seule université catholique des Territoires palestiniens, et a accompli toute sa carrière au sein de l’institution dirigée par la congrégation des Frères des Écoles Chrétiennes (ou Lasalliens, du nom de leur fondateur saint Jean-Baptiste de La Salle). Après un master à l’université de l’Oregon, elle a enseigné pendant 11 ans les Sciences informatiques et, après un doctorat en Belgique, elle est revenue à l’université de Bethléem pour diriger le département. Depuis quelques années, elle est assistante du recteur pour les Affaires académiques et a joué un rôle de premier plan dans l’adaptation des cours de l’université aux changements du marché du travail, fréquentée à 77 % par des femmes et à 81 % par des musulmans.
L’université se renouvelle
Aux facultés de Lettres, Sciences de l’éducation, Services sociaux, Sciences infirmières, Administration des affaires, Tourisme et gestion hôtelière, s’est ajoutée depuis quelques années celle d’Ingénierie, issue de l’ancienne faculté de Sciences et Mathématiques. «Ces dernières années, une forte demande a émergé dans le domaine des sciences appliquées – explique Matar – et des applications industrielles de disciplines comme la physique, les mathématiques, la chimie, la biologie. Nous avons progressivement adapté les enseignements à l’innovation technologique avec la création de l’Ingénierie, articulée en départements d’Ingénierie informatique, Biotechnologies, Ingénierie environnementale et des énergies renouvelables, et d’autres cours basés sur des simulations, des modèles mathématiques et des applications concrètes des sciences pures.»

Un moment de pause dans les cours de l’Université de Bethléem ©Université de Bethléem
Grâce à cette mise à jour continue et à la qualité de l’enseignement, l’Université de Bethléem affiche un taux élevé d’employabilité dans un contexte très pénalisé par l’occupation israélienne : en 2023, 59 % des nouveaux diplômés étaient employés, soit 774 diplômés cette année-là dans diverses disciplines, dont 81 % de femmes, en nette augmentation par rapport à 2022 où les diplômés étaient 669 (avec 78 % de femmes).
Les débouchés professionnels
«Rien qu’avec la faculté de Sciences infirmières, nous avons 100 % de nos diplômés employés dans les hôpitaux israéliens et palestiniens – souligne Muna Matar – car ce sont des professions très demandées : la majorité des inscrits aux cours d’infirmières sont des étudiantes, tandis que les cours de kinésithérapie sont principalement fréquentés par des hommes. Nos diplômés en Services sociaux trouvent également rapidement du travail en Israël : certaines de nos réussites sont dues au fait que nous préparons nos étudiants à réussir les concours en Israël.»
52,24 % des étudiants viennent de Bethléem et des deux villes voisines de Beit Jala et Beit Sahour, un peu plus d’un tiers de Jérusalem (37 %), 10 % d’Hébron. Une vingtaine d’étudiants viennent d’autres localités. L’objectif reste de former des professionnels capables de contribuer à la création et à la vie de l’État palestinien.
Les barrières à surmonter
«La vie en Palestine – conclut Matar – est âpre et difficile : le plus grand obstacle est le manque de mobilité, personne ne peut se déplacer librement ; pour le faire il faut soulever des montagnes. Malgré tout, nous faisons de notre mieux pour former de bons citoyens, en plus de professionnels qualifiés. En plus des programmes d’études des différentes facultés, chaque étudiant a la possibilité d’acquérir entre 60 et 80 crédits de formation correspondant au système universitaire européen dans des matières au choix : sciences politiques, langues étrangères (dont l’hébreu), art, éducation physique, droit, économie.»
L’espoir est qu’un jour un véritable État de Palestine voie le jour, dont le tissu social puisse tirer parti des compétences des diplômés de l’Université de Bethléem.